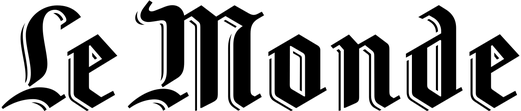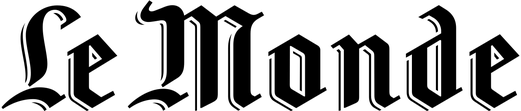PERSONNALITÉ DU MOIS : Alors que la notion de réseau se retrouve dans des disciplines très différentes (géographie, mathématiques, neurobiologie...), mon approche s’est concentrée sur les relations privilégiées existant au sein des communautés humaines ou des organisations sociales, autrement dit sur les relations interpersonnelles. La suite de l'entretien est accessible sur "la lettre SOCLE" / Mai 2024,n°47.
https://gensdeconfiance.com/socle

usage et MÉSUSAGE des réseaux sociaux
ÉMISSION RADIO : Quelle est la définition d'un réseau social ? Un réseau social au sens digital est en réalité un média social où l'information est co-produite entre le récepteur et l'émetteur en mélangeant le son, l'image et le texte dans la communication. La suite de l'interview sur le podcast ci-dessous :
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/emission-du-mercredi-28-fevrier-2024-11213

Expats à Barcelone : l’amitié à l’épreuve des réseaux
INTERVIEW : Si les réseaux sociaux ont amélioré la communication entre les expatriés et leurs proches restés en France, poster son quotidien sur Instagram ou envoyer un message n’est pas la même chose que de s’appeler. Alors, les réseaux sont-ils vraiment bénéfiques pour la vie sociale ? Enquête.
https://www.equinoxmagazine.fr/2024/08/30/expatries-et-reseaux-sociaux-faux-amis-ou-vraies-amities/

«L'État me paye, pourquoi j’irais travailler ?»
ENQUÊTE - Ils sont de plus en plus nombreux à se vanter sur les réseaux sociaux du montant des aides sociales qu’ils touchent sans travailler. Des affirmations difficiles à vérifier qui enflamment le débat politique et public.


La propagande des idées : pourquoi le Taylorisme s’est imposé en France ?
Dans la gestion d’une entreprise, le plus important n’est pas d’être efficace, mais efficient. Autrement-dit, il s’agit d’atteindre une performance économique en utilisant avec intelligence les ressources matérielles et humaines, sans les gaspiller, en cherchant à optimiser leur potentiel dans la fabrication de biens et services. Cette découverte date de la fin du XIXe siècle, avec la théorie sur l’organisation scientifique du travail. Elle vise à rendre l’industrie efficiente, grâce au découpage séquentiel des tâches dans une « chaîne de production », au sein de laquelle il est possible de surveiller les gains de productivité au travail.
Avant Taylor
Traditionnellement, on attribue la paternité de la découverte sur l’organisation scientifique du travail à un ingénieur américain Frederick Winslow Taylor qui expose les méthodes scientifiques du travail dans une brochure datant de 1911. D’après les travaux d’investigation historique menés par François Gerber et par Frédérique Barnier, cette conception est inexacte. L’organisation scientifique du travail est d’abord théorisée en France, avant de l’être aux États-Unis.
https://www.revueconflits.com/la-propagande-des-idees-pourquoi-le-taylorisme-sest-impose-en-france/

Éloge de l'autorité
L'autorité traditionnelle, ancrée dans le partage et l'évaluation critique, cède-t-elle sa place à une bureaucratie froide et déconnectée ? Dans un monde où les experts se voient supplantés par les gestionnaires, les fondations même de notre société sont-elles en train de se fissurer ? C'est l'analyse incisive proposée par Christophe Assens, professeur à l'UVSQ, Laboratoire Larequoi, et Jean-Etienne Jouillé, professeur à l'EMLV, Laboratoire DVRC. Ensemble, ils examinent la crise actuelle de l'autorité, la multiplication des règles, l'activisme des minorités et proposent des voies de réflexion pour un rétablissement durable de l'autorité.
https://www.journaldeleconomie.fr/Eloge-de-l-autorite_a12469.html

Le pouvoir d’influence américain dans la recherche en gestion en France
En imposant leurs normes de classements des revues et des écoles supérieures, les Etats-Unis ont fait main basse sur la recherche occidentale. Un pouvoir des normes qui imposent une vision du monde, notamment dans les écoles de commerce.
chaîne va Éditions
centre de diplomatie Économique

Christophe Assens : "Dans une perspective historique, je considère que le XIXe siècle a été le siècle des empires, le XXe celui des États-nations, et que le XXIe sera celui des réseaux ! J’ai rédigé le livre pour aborder les défis que recouvre cette évolution.
Il s’agit d’un défi pour les personnes : comment sortir de l’individualisme ? Il s’agit d’un défi pour les institutions : comment est-il possible de décloisonner et de renoncer à la verticalité du pouvoir ? Il s’agit d’un défi pour les États-nations : comment exercer la souveraineté en coopération avec d’autres États partenaires et rivaux à la fois ? Il s’agit d’un défi pour l’école qui ne détient plus le monopole du savoir : comment se démarquer des encyclopédies en ligne ou de l'IA ? Il s’agit d’un défi en politique : comment cultiver la popularité dans les réseaux sociaux sans perdre le sens de l’intérêt général ? Il s’agit d’un défi pour les entreprises : comment faire collaborer volontairement les salariés en dehors du contrôle exercé par la hiérarchie ? Etc. A partir d’exemples issus de l’actualité, comme la crise du covid-19, la France dans l’OTAN, le mouvement incontrôlable des Gilets Jaunes, et avec le regard croisé de plusieurs experts, l’ouvrage invite à découvrir cette révolution silencieuse de la société, dans les réseaux d’entraide où l’on cultive la liberté individuelle avec la fraternité"
les "gilets jaunes"

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Pour Christophe Assens, l'agenda de la contestation sociale n’est plus rythmé par les syndicats ou les partis politiques au gré des enjeux électoraux, mais par les réseaux sociaux.
sud radio : table ronde sur les influenceurs

LES RESEAUX SONT UN LOUP POUR L'HOMME ?
Dans cette interview, la question est de savoir si l'activité des médias sociaux présente un caractère nuisible dans l'accès et dans le traitement de l'information. Est-ce que les médias sociaux sont conduits de manière intentionnelle par une « main invisible », au sens d’Adam Smith, qui serait en mesure d’orienter la pensée d’autrui et d’influencer l’humeur des foules, accréditant l’idée d’une prédation des esprits ?
https://www.sensemaking.fr/Les-reseaux-sont-un-loup-pour-l-Homme_a461.html

LE DESARROI DE L'ETAT FACE AUX RESEAUX
L’avez-vous remarqué ? Le débat politique est devenu un exercice publicitaire où la communication l’emporte sur le fond, où l’art de plaire pour un élu est devenu une condition de survie dans l’arène médiatique. Lorsque les médias jouent le rôle "d’arbitre des élégances", le centre de gravité de la démocratie se déplace vers la politique spectacle.
https://www.nlto.fr/Le-desarroi-de-l-Etat-face-aux-reseaux_a3568.html

LE COVID NOUS A-T-IL RENDU PLUS SOLIDAIRE ?

ENTREPRISES DE RESEAU : MONOPOLE OU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE ?
Au moment de la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, le choix est fait de nationaliser les entreprises de réseau, celles qui assurent les fonctions supports de l’économie nationale, par des réseaux de distribution, dans l’énergie, les télécommunications, les infrastructures de transport routier, aérien, ferroviaire, l’eau, etc... Cette politique de reconstruction et d'aménagement du territoire national à partir des monopoles de service public, est remis en question par la création du marché unique en Europe.
https://www.journaldeleconomie.fr/entreprises-de-reseau-libre-concurrence-ou-monopole/

LE FIL D'ARIANE DES RESEAUX : PAS D'INFLUENCE SANS CONFIANCE .n°125.
Recueillir, traiter et produire de l'information sur le mode réseau constitue indéniablement un fort levier amplificateur d'influence. Le jeu intelligent du réseau repose sur l idée qu il est parfois nécessaire de sortir de l isolement, pour faire avancer des projets nécessitant les compétences de partenaires, ou pour peser collectivement sur le plan politique ou/et économique. Mais ces opérations subtiles ne peuvent fonctionner que s'il existe un socle de confiance entre les membres du réseau.
http://www.comes-communication.com/newsletter_collection.php

L'INFLUENCE ANTI-DÉMOCRATIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Au-delà des vertus des réseaux sociaux pour partager et faire circuler la connaissance scientifique, pour accélérer ou entretenir la socialisation, pour travailler à distance en cultivant l’intelligence collaborative, des problèmes se posent avec les nouveaux canaux de communication digitale. Ils font perdre parfois « la sagesse des foules » lorsque les flux d’information détournent l’attention des enjeux pour la démocratie.
http://www.politiquematin.fr/l-influence-anti-democratique-des-reseaux-sociaux-51889

LES RESEAUX POUR SAUVER LA PLANETE
Il devient urgent de réfléchir à la question du développement durable, c’est-à-dire sur la manière de préserver un modèle de civilisation fondé sur la croissance économique et le progrès scientifique, sans détruire définitivement la planète.
https://www.rse-magazine.com/Les-reseaux-pour-sauver-la-planete_a4405.html

ROBOTS, UNE SOUMISSION PROGRAMMEE ?
"L’autorité du robot n’est jamais légitime, car un outil doit rester au service de l’homme. Ce n’est pas l’outil qui commande la pensée. Aussi « intelligent » soit-il un robot est toujours l’émanation d’une programmation humaine. Nous avons tendance à l’oublier à une époque où nous refusons de fournir des efforts intellectuels, par habitude ou par paresse, en pensant que les applications numériques répondront à tous nos besoins de connaissance, et à tous nos désirs émotionnels... "
https://www.rse-magazine.com/Robots-une-soumission-programmee_a4342.html

LES RÈGLES, JEU D'ENFANT OU PROBLÈME DE SOCIÉTÉ ?
"La réglementation excessive de la société est un fléau. Tout d’abord l’accumulation de règles inutiles est déshumanisante, comme s’il était possible de tenir à distance tous les maux de la société par un « cordon sanitaire » juridique et administratif. Plus le cadre devient restrictif, moins les citoyens prennent le temps de se parler pour résoudre des contentieux. La société devient plus violente et se judiciarise au détriment du dialogue social..."
https://www.nlto.fr/Les-regles-jeu-d-enfant-ou-probleme-de-societe_a2881.html
responsabiliser au lieu de priver de liberté
Fake News et Coronavirus : responsabiliser au lieu de priver de liberté ! Tant face à l'épidémie que face aux désinformations qu'elle génère, les politiques liberticides sont peu efficaces, estime Christophe Assens, professeur à l'université de Paris Saclay. Il faut miser sur la responsabilité individuelle.
Régulièrement, les réseaux sociaux sont assaillis de fausses nouvelles. L'épidémie mondiale du Coronavirus n'échappe pas à la règle. Les théories de désinformation propagées par des attaques informatiques provenant de Russie font croire que le virus a été créé par les Etats-Unis dans la guerre économique avec la Chine, que c'est une arme biologique inventée par la CIA ou qu'elle fait partie d'une stratégie occidentale de messages anti-chine...
BLOG ChâteauForm
[Interview] Christophe Assens, docteur en sciences de gestion : Les facteurs clés du succès du management en réseau
À quels défis majeurs les entreprises travaillant en réseau sont-elles confrontées ?
Votre dernier livre s’intitule : « le management des réseaux : tisser du lien social pour le bien-être économique » ; pourquoi parvenir à tisser du lien social est-il un enjeu stratégique ? Quel est le lien de cause à effet avec la notion de bien-être économique ?

Tribune le 27 janvier 2016 dans le Cercle Les Echos en collaboration avec Francis Hintermann Directeur de la recherche Monde - Accenture : "La pyramide hiérarchique perd-elle la tête ?" Les nouveaux codes du management collaboratif remettent en question les principes traditionnels de l'autorité. Quels sont-ils ?

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Pour Christophe Assens, les réseaux sociaux numériques sont au cœur d'un étrange paradoxe : s'ils permettent l'éruption d'une colère sociale, ils sont en revanche incapables de pallier la dissolution des liens sociaux dont les «gilets jaunes» sont aussi l'expression.

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans Réseaux sociaux, tous ego ? Christophe Assens développe une analyse des réseaux sociaux au prisme des besoins humains. Il pense que notre usage quotidien de ces plateformes engendre des bouleversements anthropologiques insoupçonnés.
université paris saclay
Pour répondre aux limites de la massification de l’enseignement public, l’incursion du secteur privé dans l’accompagnement scolaire devient un phénomène de plus en plus répandu. Est-ce que cette intrusion des entreprises privées préserve les missions du service public, sur l’égalité des chances, la continuité et la mutabilité de l’enseignement ?
http://www.afae.fr/wp-content/uploads/2017/06/Assens-Business-de-léduc-V7.pdf

Aux confins de l'Ile-de-France, la zone d'emploi de Houdan et les 28 communes qui la composent affichent le taux de chômage le plus bas de France: 4,7%. Si certains arguent d'une coopération fructueuse entre entreprises et pouvoirs publics, la statistique cache une réalité plus complexe. Sur ce discret territoire niché entre Dreux et Versailles, en bordure de forêt de Rambouillet, s'étend une campagne préservée, à une heure de voiture de Paris...
patron employés : même salaire !

Dan Price, PGD de Gravity Payments, start-up américaine basée à Seattle attire l'attention des médias du monde entier. Il adopte une mesure inédite en matière de rémunération. Il décide d'aligner la rémunération de tous les employés à hauteur de 70000 dollars par an, chiffre à partir duquel il évalue sa propre rémunération...
https://www.journaldeleconomie.fr/Patron-employes-meme-salaire-_a2342.html
Faut-il tendre la main a son concurrent ?

Tendre la main à son concurrent pour survivre, est devenu un enjeu majeur dans le monde complexe d'aujourd'hui. Lorsque les concurrents ne sont plus en mesure de s’adapter de façon isolée aux variations de conjoncture, de technologie ou de réglementation, il est alors nécessaire de pratiquer la "coopétition", la coopération dans la compétition...
https://www.journaldeleconomie.fr/Faut-il-tendre-la-main-a-son-concurrent_a916.html

Au coeur d’un festival, le rôle des financeurs (publics et/ou privés) semble prédominant. Est-il pertinent de construire un réseau de partenaires autour des attentes prioritaires des financeurs, pour assurer le succès de l’évènement artistique et culturel ?
RADIO FRANCE INTERNATIONAL
C'est ce 5 novembre 2012, que Louis Gallois, ancien patron d'EADS devrait remettre son rapport sur la compétitivité au gouvernement français. Il devrait ensuite prendre des mesures sur le coût du travail, mais aussi l'innovation.
Au coeur de ces discussions: le rôle des pôles de compétitivité. A l'initiative de l'Etat et des collectivités territoriales, ces pôles regroupent des laboratoires de recherche publics, des grands groupes et des petites entreprises pour stimuler l'innovation. Instaurés en 2005, l'heure est aujourd'hui au bilan... (interview réalisé dans l'émission "Grand Reportage" pour Gaëlle Laleix)...
http://www.rfi.fr/emission/20121105-pole-competitivite-le-choix-francais-innovation
PORTAIL DE L'IE

Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, mais surtout de crise de confiance, l'innovation apparaît comme cruciale pour toutes les régions du monde y compris dans les grandes métropoles comme Paris.
Dans ce contexte, la compétitivité de l’économie régionale repose sur la création des écosystèmes, entendus comme des réseaux d'acteurs publics et privés, qui essayent soit de maintenir leur avantage concurrentiel soit de rattraper le retard accumulé dans cette course effrénée à l'innovation et à la compétitivité des territoires.